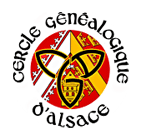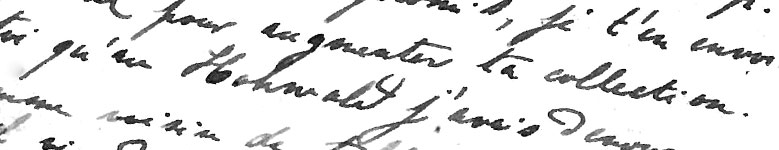Bonjour,
Après la défaite des Suédois à Nördlingen (1634), le Magistrat, inquiet pour ses libertés, envoie son syndic J. H. Mogg à Paris pour négocier un accord et se mettre sous la protection royale. Il obtient satisfaction pour la signature le 1er août 1635 de l'accord de Rueil, confirmé deux jours plus tard par Louis XIII. Le roi de France prend la ville de Colmar sous sa protection, mais la situation de 1618 sera rétablie dès la signature de la paix. La ville conserve ses privilèges, libertés et droits. Les deux confessions peuvent exercer librement leurs cultes. Le commandant militaire est chargé de maintenir l'ordre et la discipline de la garnison. Il dispose d'une clé de la ville, l'autre étant remise à l'"Obristmeister" (chef annuel du Magistrat).
Dans les années suivantes, les rapports entre la ville et le gouvernement royal sont corrects, ce qui explique que le traité de protection de 1635 est renouvelé sans changement en 1644. La situation ne se dégrade que dans les années 1660 quand les pressions françaises sur le Magistrat deviennent plus menaçantes.
A partir du XIXe siècle, et surtout après 1918, lorsque la patriotisme français, sous l'influence de Hansi, se développe, le traité de Rueil devient le symbole des liens avec la France. En septembre 1935, le tricentenaire de la "réunion de Colmar à la France" est le prétexte de cérémonies fastueuses, en présence du président de la République Albert Lebrun. Mais il s'agit "avant tout d'affirmer son attachement à la France en faisant contre-poids à la propagande autonomiste".
Bernard Vogler, L'Almanach de l'Alsace, p. 223.
https://dhialsace.bnu.fr/wiki/Colmar_(v ... _1214-1815)
https://www.alsace-histoire.org/netdba/11407/
https://www.alsace-histoire.org/netdba/ ... jacques-d/
https://www.amicale-alsaciens-lorrains- ... ieu-rueil/
Bien cordialement,
Philippe
1.8.1635 Traité de Rueil
1 message
• Page 1 sur 1
1 message
• Page 1 sur 1
Retour vers Professions, titres, fonctions, institutions
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 5 invité(s)